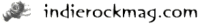2017 dans l’oreillette - Best albums pt. 7 : 40 à 31
100 albums en 10 parties, pour renouer avec ma formule chronophage des années 2014 et 2015, car après 30 EPs il fallait au moins trois fois ça. Et surtout parce que quand on aime, on ne compte pas, et qu’il n’y a finalement pas une différence fondamentale dans mon cœur entre, mettons, le 50e et le 100e de cette sélection, simple question d’humeur et d’envie du moment.

Le fait est que tous ces choix, et même une dizaine d’autres laissés de côté pour des raisons de symétrie, m’ont fasciné, touché et marqué de diverses façons, d’écoutes-expériences dont je laisserai l’effet s’estomper quelques mois voire même quelques années avant d’y revenir en quête du plaisir intact de la (re)découverte, en albums-compagnons qui ont su chauffer ma platine virtuelle à intervalles réguliers. Quant aux musiciens mis en avant dans cette 7e partie, qu’ils soient beatmakers, sculpteurs de textures ou instrumentistes/arrangeurs, ils sont avant tout chefs-d’orchestre de leurs propres tourments intérieurs ou metteurs en scène de leurs petits mondes allégoriques avec des albums narrativement ambitieux et d’une richesse qui me fait déjà regretter de ne pas avoir pu leur faire gagner quelques places supplémentaires.
40. Ari Balouzian - Western Medicine (Nowness)
Déjà de retour ce mois-ci avec l’hantologique et hanté Mood of the Era Vol. 1 aux expérimentations plus synthétiques dont on reparlera, celui dont on célébrait les publications il y encore quelques années sous l’alias Cliff Dweller met en avant des cordes viscérales tantôt mélancoliques (Chapel, Poppies), menaçantes (Dervish, le flippant First Snow avec ses samples de discours belliqueux et sa chorale de damnation), lancinantes (The Roof Caved In, Torch) et des percussions mystiques (She Ran) ou plus martiales (Prayers I) sur cette suite évoquant le désert de Syrie, l’austérité et le danger permanent qui y règnent depuis le début de la guerre civile, mais aussi le radicalisme des visions sociales qui s’y confrontent avec pour point commun le mépris de l’humain. Les bénéfices de la vente de cette sortie vinyle aussi poignante que minimaliste seront d’ailleurs intégralement reversés à Médecins Sans Frontières pour aider les victimes de la Bataille d’Alep, vers l’espoir d’un apaisement symbolisé par l’élégiaque Dronal... avant que les drones, les vrais, ne frappent à nouveau.
39. Raz Ohara - Like A Jungle Sometimes (Budde Music)
"Avec ce nouvel album solo, successeur de Moksha, le vocaliste danois du génial Apparat nous aura impressionnés cette année par son sens de l’épure hypnotique et de la suspension deep inégalé dans un post-dubstep croulant depuis quelques années sous les ersatz d’un James Blake à court d’élégance et d’idées. Et dieu sait que des idées, Patrick Rasmussen n’en manque pas, à commencer par la plus fameuse d’entre toutes, plonger ses racines à la source de toute bonne pop électronique aventureuse et syncopée qui se respecte, celle de Massive Attack et de son faux trip-hop aux beats vertigineux et aux nappes mouvantes, dès l’entame d’album AAP (Artists Are Pussies). Il faut dire que du propre aveu de l’intéressé, c’est bien l’époque de ses premiers travaux, c’est à dire les 90s, qui berce ces 7 morceaux ensorcelants autant que vénéneux, et You Say Party I Say Die enfonce le clou d’une filiation justifiée avec la clique de 3D et Daddy G, point d’orgue d’une plongée remarquable dans les tréfonds du subconscient... une jungle parfois."
< lire la suite >
38. Jessica Moss - Pools Of Light (Constellation)
S’il reste quoi que ce soit des paysages de désolation et des élégies lancinantes des grandes heures du Silver Mt. Zion Memorial Orchestra dont on regrette un peu plus aujourd’hui sortie après sortie l’époque du fabuleux Born Into Trouble as the Sparks Fly Upward, c’est bien du côté de sa violoniste Jessica Moss dont ce deuxième album solo (le premier largement distribué, par Constellation qui plus est) déroule sur trois suites plus ou moins menaçantes (Entire Populations), fantasmagoriques (Glaciers I) ou méditatives (Glaciers II) ses BOs imaginaires d’un monde sur le déclin et autres mantras ténébreux d’extinction de l’espèce humaine (Entire Populations, Pt. II). A la croisée d’un dark ambient à cordes frottées et d’un classique contemporain hanté, Pools of Light rappelle que le post-rock du label canadien en sa période bénie était d’abord une porte ouverte sur des horizons musicaux plus ardus dont les émotions ambiguës et les affleurements de mélancolie déchirants (Entire Populations, Pt. IV) se méritent.

37. Pierre Lapointe - La Science Du Cœur (Audiogram)
Cousin québécois du Biolay de la grande époque depuis La forêt des mal-aimés qui mêlait déjà il y une douzaine d’années héritage gainsbourien (avec Françoise Hardy en muse, et Ferré à la place de Trenet comme troisième point cardinal chansonnier), ambition mélangeuse, orfèvrerie des arrangements et vision crue voire même parfois morbide et quoi qu’il en soit assez désespérée des relations amoureuses, Pierre Lapointe est désormais le dernier porte-étendard francophone de cette violence des sentiments sur fond de lyrisme orchestral et d’une introspection sans pudeur ni garde-fou (cf. le faussement enlevé et vraiment déprimant Sais-tu vraiment qui tu es). Sur La Science du Coeur, entre deux hymnes à l’amour gay, ses espoirs et ses revirements universels (de la ferveur du désarmant Le retour d’un amour aux regrets d’Une lettre, en passant par la résignation médicamentée de Zopiclone), l’auteur du génial Punkt décline son mal-être de trentenaire des 10s tragiquement conscient de sa propre vanité (la symphonie du morceau-titre et son poignant crescendo d’ellipses existentielles), peu à peu gagné par la misanthropie (la mélodie de piano crève-cœur et les cordes infiniment tristes du sommet Qu’il est honteux d’être humain) et l’insomnie (le crépuscule romantique des cascades pianistiques de Naoshima), et tourmenté par les derniers éclats pop d’une candeur qui n’appelle qu’à être déçue (Mon prince charmant, flûte guillerette et saxo anachronique en avant). Quant au reste du disque, il fait feu de tout bois, flirtant avec la tragédie opératique sur Comme un soleil, les polyphonies cristallines de Steve Reich sur Un cœur ou même l’EBM avec l’abécédaire très personnel d’Alphabet et sa profession de foi qui révèle tout ce que le Canadien doit à l’amour de l’art en général.
36. Bummed Owl - Bummed Owl (Us Natives)
On ne saura peut-être jamais qui se cache derrière cet avatar de hibou tristounet, ni si l’on a raison de soupçonner Ill Clinton, patron du label Us Natives crédité à l’artwork de ce chef-d’œuvre de concision qui n’est pas sans rappeler l’épure low-end rétro-futuriste et intrigante d’A M B A P, de Vapor Cave ou de ses récents Skywalken III et Juniper EP. On retrouve en effet sur cet éponyme du mystérieux Bummed Owl le même genre de mélancolie sous lexomil, cette économie de moyens qui phagocyte folk de chambre (OffRoads), musique latine (Ucalyptic), sountracks baroques de films noirs d’époque (Krepsr), BOs à synthés des années 80 (EctoVision) ou encore la soul et le trip-hop (SheNoeShoww, DontEver) pour les plier à son imaginaire de SF vintage et mélancolique. Un voyage sur Vénus sert d’ailleurs de toile de fond à ce mini-album instrumental à écouter en boucle, qui culmine sur le spleen acoustique crépitant au groove cristallin d’AllTheRain, du plus ambient HurrelHer ou de l’insidieux Equinocks, mais plus encore sur John dont l’ambiance narcotique d’anticipation vintage en noir et blanc évoque l’atmosphère de The Twilight Zone et pourquoi pas du génial Ragnarok (pour tenter une dernière fois de faire sortir du bois le producteur ricain que l’on retrouvera de toute façon dans la dernière partie de ce classement).
35. Aidan Baker / Simon Goff / Thor Harris - Noplace (Gizeh)
Impressionnant de tension et d’abstraction mêlées, de densité atmosphérique et d’efficacité, Noplace voit l’insaisissable créateur de formes canadien, ici à son instrument de prédilection - une guitare aux effets dronesques ou liquéfiés pour sonner parfois plus proche d’un synthé que d’une six-cordes - dialoguer avec l’ex batteur de Swans et Shearwater, Thor Harris (déjà présent sur quelques titres de l’excellent The Spectrum of Distraction 5 ans auparavant) et le violoniste britannique Simon Goff avec lequel il s’était déjà produit en trio en compagnie du bassiste James Welburn. Qu’il figure en soutien martial (Northplace) voire délicatement syncopé (Noplace II) ou qu’il mène la danse via une dynamique tantôt implacable (Tin Chapel) ou feutrée (Noplace III), Harris ne manque jamais de laisser suffisamment d’espace à Aidan Baker pour développer ses textures en véritables édifices aux effluves rétro-futuristes (Red Robin, Northplace) ou mythologiques (Noplace III, Nighplace) tandis que Goff apporte le soupçon nécessaire de lyrisme capiteux (Noplace I) ou de stridence angoissée (Red Robin) pour tirer la géométrie de l’ensemble vers une forme de dramaturgie presque cinématographique, dans ce genre d’entre-deux qui sied si bien au guitariste de Nadja, ces jams semi-improvisés à la croisée de l’ambient et du space rock capables de focaliser notre attention sur le début d’un crescendo d’intensité pour mieux se jouer de nos sens et nous désorienter l’instant d’après.
34. Chris Weeks - The Grey Ghost Of Morning (Archives)
En bonne position de mon bilan EPs avec son projet Kingbastard qui en remontre désormais à Autechre en matière d’IDM malaisante et déstructurée, Chris Weeks continue également de décliner cette ambient fantasmagorique et embrumée qui a pris le pas ces dernières années (Haverfordia en témoignait en 2016) sur les radiations drone plus cosmiques et claustrophobiques qui ont valu au Britannique pas moins de 5 mentions parmi mes tops ten annuels cette décennie (et au moins autant en format court). Composé cette fois dans un contexte de solitude et d’insomnie alors qu’un retour au Pays de Galles l’isolait de sa fiancée restée aux États-Unis, The Grey Ghost Of Morning voit notre Américain d’adoption triturer toutes sortes de guitares et de basses de toutes sortes de façons (pour un résultat parfois proche d’une symphonie de synthés dronesques comme sur Killing Time ou Escaping Brainfog) pour exprimer cette détresse par moments presque sépulcrale (The Mourning) de la séparation (l’angoissé Empty Nest) et du manque de sommeil (les désincarnés Shuteye et Limbo), la menace de l’aube et de ses tourments de lumière (A Pool of Light), les crépitements humides du brouillard environnant (Spiders & Plugholes) et cette atmosphère d’hallucination permanente qui devient notre quotidien lorsque l’impossibilité de dormir nous transforme en fantôme errant dans la pénombre d’une chambre aux fenêtres barricadées pour tenir à l’écart les faibles rayons d’un soleil matinal (Lonesome Ghost, Phantasm).
33. From the Mouth of the Sun - Hymn Binding (Lost Tribe Sound)
Pas facile de passer après ce qui sera à n’en pas douter l’un de mes albums de la décennie, Aaron Martin et Dag Rosenqvist l’avaient pourtant fait avec le presque aussi sublime Into the Well en optant pour une approche plus contrastée, entre isolation poignante des instruments et crescendos de luxuriance électro-acoustique à l’intensité décuplée. Sur ce troisième opus, inférieur aux deux précédents faute d’ampleur mais sans démériter au regard de cette place de choix, From the Mouth of the Sun alterne entre les deux, d’un côté les micro-symphonies orchestrales et dronesques à la fois du parfait Woven Tide (A Breath to Retrieve Your Body, Grace), de l’autre ces progressions lyriques qui s’étoffent et gagnent en puissance sans rien perdre de leur délicatesse (Light Blooms in Hollow Space, le presque Godspeed-esque Risen, Darkened et sa courte marche apocalyptique émergeant d’un quasi silence) tout en nous gratifiant de quelques plages au réconfort plus épuré et dénudé, à l’image de The First to Forgive et The Last to Forgive ou de l’élégiaque et tintinnabulant Roads aux accords de piano lentement égrenés sur fond de cordes enivrantes.
32. Ghostpoet - Dark Days + Canapés (PIAS)
"Produit par l’ingé son et guitariste Leo Abrahams, Dark Days & Canapés témoigne à la fois de l’aboutissement d’une évolution désormais évidente qui s’est faite petit à petit à coups de guitares claires-obscures et d’arrangements spleenétiques à la façon du Pulp du tournant des 00s ou des Tindersticks des 90s (avec son piano crépusculaire et ses trémolos de guitare désespérés, Many Moods At Midnight en est ici l’exemple le plus frappant) voire pourquoi pas Talk Talk (influence avouée du beau Blind As A Bat... avec son trio de cordes impressionnistes sur fond de guitare méditative aux accords épurés), et de l’inéluctabilité d’une trajectoire déjà perceptible en filigrane sur un Peanut Butter Blues & Melancholy Jam dont on vantait à sa sortie la digestion aussi intense qu’élégante de tout un héritage bristolien mélangeur, via Massive Attack en particulier. Woe Is Meee voit d’ailleurs Daddy G partager le micro avec son disciple avoué le temps d’un western existentialiste à la Jamaïcaine, qu’il habite en seconde moitié de son timbre enfumé, cool et vénéneux à la fois, celui-là même auquel on doit la réinvention du spoken word sur un Blue Lines qui n’a pas manqué de marquer de son empreinte hybridatrice l’ensemble des travaux de Ghostpoet."
< lire la suite >
31. Jacaszek - Kwiaty (Ghostly International)
Si Michał Jacaszek ne renie rien de son goût pour les atmosphères de cathédrale à ciel ouvert aux instrumentations baroques (cordes pincées et claviers anciens délicatement associés à une électronique cristalline, aux exhalaisons des drones et à quelques synthés) et aux textures électro-acoustiques chancelantes, la présence au chant d’une certaine Hanna Malarowska du duo Hanimal et de deux autres vocalistes aux harmonies liturgiques fait de ce Kwiaty l’album le plus pop du Polonais. Mais un album pop tristounet de Paradis Perdu aux mélodies à peu près aussi guillerettes que celle du Summer Make Good de múm il y a une petite quinzaine d’années (To Violets, To Blossoms), dont les fleurs aux couleurs passées seraient d’une beauté trop fragile pour être admirée bien longtemps et les sentiments trop éphémères pour laisser autre chose qu’une douloureuse empreinte dans les cœurs. Inspiré par les poèmes de l’Anglais Robert Herrick qui ne disait pas autre chose sur la brièveté du bonheur et l’imminence de la mort, Kwiaty en est d’autant plus insaisissable, capiteux et finalement fascinant, à la croisée de la passion et du sacré, de l’immédiat et de l’immatériel (To Perenna, To Meadows, et surtout le fabuleux Eternity digne du chef-d’œuvre Treny).